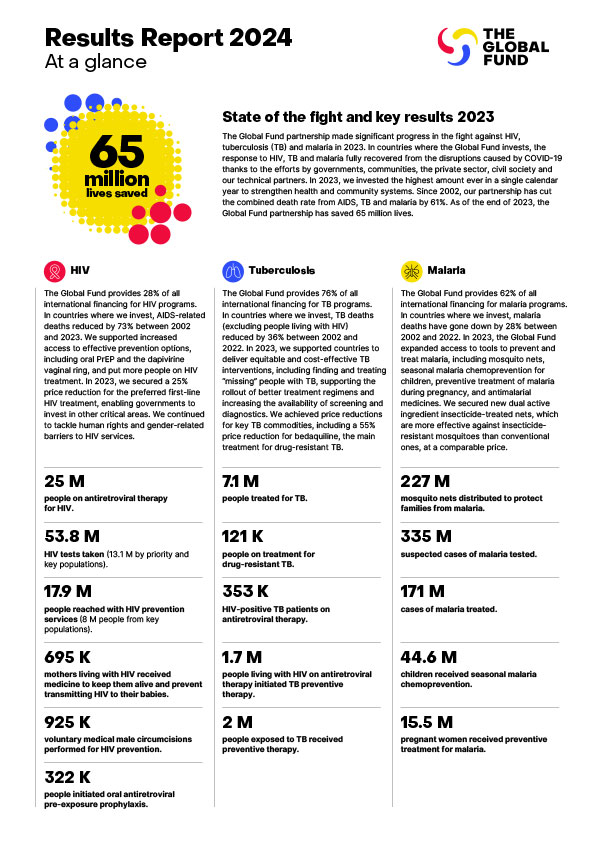Quand la finance est défaillante : pourquoi les économistes n’ont pas vu venir l’effondrement lié à la pandémie de COVID-19
Si j’ai observé une chose en dirigeant d’abord une grande banque internationale et maintenant une organisation qui œuvre pour la santé dans le monde, c’est bien l’abîme d’incompréhension mutuelle qui sépare les mondes de la finance mondiale et de la santé mondiale.
Les dirigeants du secteur financier n’ont pas pris au sérieux les risques économiques associés aux épidémies de maladies infectieuses. Et les responsables de la santé n’ont pas compris pourquoi.
Ce fossé explique notre manque de préparation face à la pandémie ainsi que les mesures hésitantes et déséquilibrées qui ont été prises dans l’affolement pour y répondre.
Dans la mesure où l’histoire, l’analyse et la situation actuelle semblent montrer que les flambées de maladies infectieuses constituent l’une des plus grandes menaces pour la croissance économique, comment se fait-il que ces risques soient si rarement évoqués dans les analyses macroéconomiques ?
En 2016, après avoir quitté Standard Chartered et avant d’exercer mes fonctions actuelles au Fonds mondial, je me suis penché sur cette question durant mon bref séjour à Harvard comme universitaire. Avec le concours de deux collègues de l’université, j’ai commencé par me demander si les risques sanitaires étaient réellement sous-estimés dans les prévisions économiques. En partant d’un échantillon de quinze pays ayant subi des flambées épidémiques − comprenant notamment Hong Kong avec le SRAS et la Corée avec le MERS −, nous avons étudié les rapports pertinents publiés par le Fonds monétaire international, le service de recherche du magazine The Economist et Standard & Poor’s, portant à la fois sur les deux années antérieures et les deux années postérieures à chaque épidémie, soit quelque 400 rapports au total. Nous voulions voir si ces institutions de renom avaient considéré que ces épidémies avaient eu un impact significatif sur l’économie des pays concernés après l’épisode, et si elles avaient pris en compte le risque épidémique comme une menace potentielle pour l’économie avant que l’événement ne se produise.
Les résultats obtenus ont été frappants. Pour ce qui est du FMI, l’impact sur l’économie était mentionné dans 63 % des rapports rédigés après les flambées épidémiques observées dans les 15 pays considérés. En revanche, pas un seul rapport du FMI portant sur les 15 pays étudiés et rédigés au cours des deux années ayant précédé l’épidémie ne faisait état du risque épidémique pour l’économie de ces pays. Et le constat est le même en ce qui concerne Standard & Poor’s et le service de recherche du magazine The Economist.
J’avoue que tous mes efforts visant à combler cette lacune ont largement échoué. J’ai consacré beaucoup d’énergie à essayer de convaincre le FMI d’intégrer les risques sanitaires dans ses analyses économiques, et plus particulièrement dans ses évaluations périodiques des politiques et de l’économie des pays menées au titre de l’Article IV, tout cela en vain. Nous avons organisé des séminaires destinés aux chefs d’entreprise afin que ceux-ci puissent réfléchir à l’impact d’une épidémie sur leurs activités (notamment un séminaire organisé en 2017 autour d’un scénario basé sur l’apparition en Chine d’un coronavirus plus contagieux que le virus responsable du MERS), mais nous nous sommes retrouvés face à des participants venus en grande partie d’entreprises du secteur de la santé publique. Plus récemment, il y a plus d’un mois, j’ai écrit à quelques-uns des plus grands investisseurs institutionnels et banquiers centraux du monde − des personnes que je connais personnellement − en leur disant qu’il fallait vraiment que nous parlions de l’épidémie de COVID-19. La plupart ne m’ont pas répondu. Les services de l’un deux m’ont proposé un rendez-vous pour cet été.
Depuis, bien sûr, les marchés boursiers ont plongé − une chute d’une ampleur encore plus importante qu’en 2008. Les banques centrales ont tenté à plusieurs reprises d’enrayer le désastre en déployant tout un ensemble d’outils mis au point durant la crise financière. Or, malgré une aide qui se compte en milliers de milliards de dollars, les marchés ont continué à sombrer.
Pourquoi des économistes et des financiers de tout premier plan ont-ils à ce point refusé de voir les risques que représentent les épidémies de maladies infectieuses ? Et pourquoi des outils si performants lors de la crise financière n’ont-ils pas été aussi efficaces cette fois-ci pour endiguer la débâcle sur les marchés financiers ?
L’une des raisons est que les analystes économiques, comme les humains de manière générale, peinent à appréhender des risques qui ont peu de chances de se concrétiser mais dont les conséquences sont potentiellement gigantesques. Nous oscillons généralement entre une surestimation extrême (attaques de requins, terrorisme) et une sous-estimation flagrante (crises financières, pandémies) de ces risques.
Une deuxième raison est le fait que les économistes et les financiers semblent bien plus à l’aise à l’idée d’évaluer des risques qu’ils arrivent à cerner. Je me souviens d’une conversation révélatrice avec un haut fonctionnaire du FMI qui m’expliquait la raison simple pour laquelle ils incluaient des facteurs comme les prix des matières premières dans l’évaluation des risques macroéconomiques, mais pas les facteurs d’ordre sanitaire : les matières premières sont un sujet que les économistes maîtrisent, contrairement à l’épidémiologie, et les données sur les matières premières sont de meilleure qualité par rapport aux données sur les épidémies de maladies infectieuses.
La tendance des acteurs de la santé mondiale à présenter tous les problèmes sanitaires comme une priorité urgente en s’appuyant sur des analyses souvent excessives et peu fiables n’a probablement pas arrangé les choses.
La raison pour laquelle les interventions massives des banques centrales et des gouvernements ont été pour l’instant moins efficaces pour calmer la panique sur les marchés paraît évidente. Pendant la crise financière mondiale, les mesures prises par les banques centrales et les ministères des finances − injecter des capitaux et fournir des liquidités − visaient à remédier en même temps aux conséquences et aux causes de la panique. Cette fois-ci, les banques centrales peuvent toujours contribuer à atténuer l’impact immédiat de la pandémie, mais remédier à la cause première de la maladie, à savoir l’agent pathogène lui-même, sort de leur champ d’action. Tant que nous ne serons pas venus à bout de cette pandémie, leur action se limitera à empêcher que les conséquences économiques et financières de cette crise n’échappent à tout contrôle.
Or, c'est précisément là que la réponse politique apparaît complètement déséquilibrée. Alors que plusieurs milliers de milliards de dollars ont déjà été mobilisés pour atténuer les conséquences économiques de cette crise sanitaire, il a été jusqu’à maintenant extrêmement difficile de trouver quelques centaines de millions − ne parlons même pas de milliards − pour tester et traiter à grande échelle et pour accélérer le développement et le lancement de nouveaux tests de dépistage, de nouveaux médicaments ou de vaccins. Pensez, par exemple, à la réaction des marchés si des chercheurs venaient à découvrir rapidement un traitement de la COVID-19 qui réduirait de moitié le taux de mortalité. Demandez-vous ensuite pourquoi le monde de la finance ne se précipite pas pour soutenir des initiatives comme le Therapeutics Accelerator, lancé il y a quelques semaines par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard. Dotée d’un financement initial de 125 millions de dollars, cette plate-forme est conçue pour, d’une part, financer et coordonner des essais à grande échelle de médicaments existants tombés dans le domaine public pour traiter la COVID-19, comme la chloroquine et divers antirétroviraux, et d’autre part, faciliter la production massive de ces médicaments si les résultats sont concluants. Pour des médicaments dont le brevet n’est pas arrivé à échéance, comme le remdesivir des laboratoires Gilead, il y a une incitation économique à investir, ce qui n’est pas le cas pour les médicaments tombés dans le domaine public. Pour remplir efficacement sa fonction, le Therapeutics Accelerator a besoin d’environ 3 milliards de dollars.
La pandémie de COVID-19 est un défi sanitaire dont les répercussions sont considérables tant sur le plan humain que sur le plan économique. Il est impératif de rééquilibrer notre riposte à cette pandémie en consacrant davantage de ressources à la lutte contre le virus lui-même. Nous devons par ailleurs profiter cette occasion pour combler ce fossé entre les mondes de la santé et de la finance.
Peter Sands est le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a auparavant occupé le poste de directeur général de la banque Standard Chartered.
Cette tribune a d’abord été publiée dans l’hebdomadaire Barron’s.