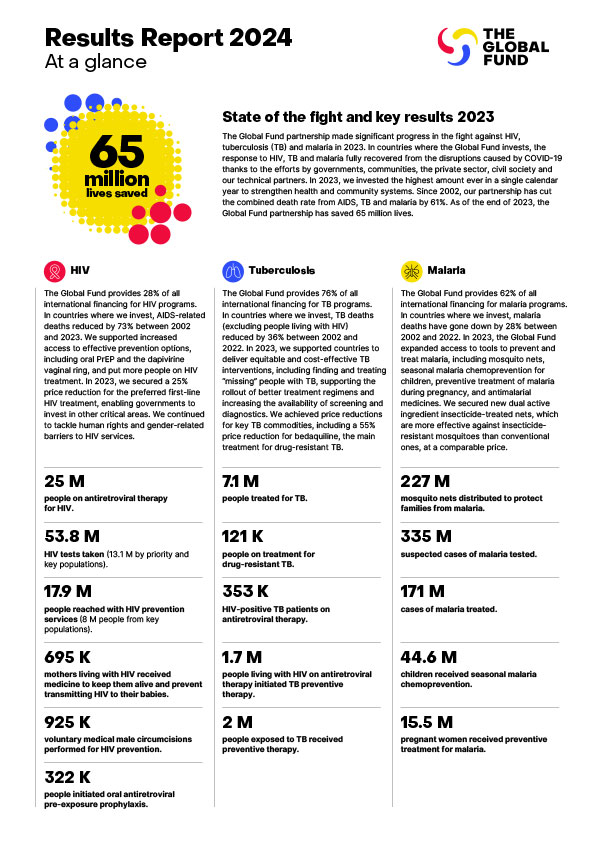Finalement, qui est concerné par la pandémie ?
Pris dans le tumulte du « nationalisme vaccinal » et du partage des doses, nous risquons de passer à côté d’un élément absolument fondamental, à savoir qu’il ne s’agit pas simplement de garantir un accès équitable aux outils de lutte contre la pandémie, mais aussi de définir de manière équitable ce qu’est une pandémie. L’emploi du terme « pandémie » n’est pas qu’une question de sémantique : il est plutôt question de décider qui doit vivre et qui doit mourir.
Les niveaux élevés de couverture vaccinale dans les pays les plus riches permettant un retour progressif à la normale, les membres du G7 se concentrent davantage sur la prévention des futures pandémies que sur la lutte contre le COVID-19. S’il peut paraître logique, du point de vue des grandes puissances, de vouloir saisir l’occasion de se protéger contre de futures menaces, il est préoccupant, du point de vue des autres pays, de constater qu’un schéma ancien semble se reproduire : dès qu’une pandémie cesse d’être une menace sérieuse pour les populations les plus riches, l’urgence disparaît, les priorités changent et les ressources diminuent. C’est ce que nous avons fait pour les pandémies précédentes, le sida et la tuberculose par exemple : agir de manière décisive pour contenir la menace pesant sur la vie des personnes dans les pays riches, mais laisser des millions de personnes mourir parmi les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables dans le reste du monde.
Le sommet du G7 a coïncidé avec le quarantième anniversaire des recherches sur le premier groupe de cas de sida en 1981. Il est inquiétant de constater que cela fait quarante ans que nous luttons contre la dernière grande pandémie à l’échelle mondiale, et que plus de 34 millions de personnes en sont mortes. Dans le même temps, la tuberculose, largement oubliée dans les pays riches, fait encore environ 1,5 million de morts chaque année. Il s’agit de la maladie infectieuse la plus meurtrière après le COVID-19.
Cependant, bien que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme continuent de tuer des millions de personnes dans nombre de pays et de régions, on ne parle plus de pandémie pour ces maladies, mais plutôt d’épidémies ou de maladies endémiques. Cette distinction a des implications inquiétantes. En effet, on entend par « épidémie » une pandémie qui ne fait plus de victimes dans les pays les plus riches, et l’on qualifie d’« endémique » une maladie dont on aurait pu se débarrasser, mais dont on s’est gardés de le faire.
Il n’y a rien d’inévitable dans le fait que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme soient des épidémies ou des maladies endémiques. Nous avons prouvé qu’il s’agissait de pandémies auxquelles nous pouvions mettre fin, car cela a été fait dans les pays riches. Leur permettre de persister est donc un choix politique et une décision budgétaire.
Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire craignent désormais que la même chose se produise avec le COVID-19. Le fait que l’on commence à parler d’endémie du nouveau virus doit nous alerter.
Ces préoccupations seront alimentées par la panoplie de nouvelles approches et de nouveaux financements pour la préparation et la riposte aux pandémies qui seront proposées par d’augustes instances, telles que le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, le partenariat de riposte à la pandémie et le futur comité indépendant de haut niveau du G20. Va-t-on mobiliser de nouvelles ressources massives pour se protéger contre les futures menaces de maladies infectieuses, tout en cessant de financer la lutte contre le COVID-19, le VIH, la tuberculose et le paludisme, la polio, Ebola, l’hépatite et les autres menaces actuelles? Pire encore, allons-nous réaffecter les fonds consacrés à la lutte contre les pandémies en cours à la prévention des nouvelles pandémies ?
Bien que les rapports mettent l’accent sur l’accès équitable aux outils de lutte contre les pandémies, aucun d’entre eux ne s’attaque à un point fondamental : tant qu’une pandémie ne sera définie comme telle que lorsqu’elle fait des victimes dans les pays riches, la préparation et la riposte manqueront foncièrement d’équité. S’il est certes fondamental de garantir un accès équitable aux outils de lutte contre les pandémies, il est encore plus essentiel de définir de manière équitable ce que l’on entend par pandémie.
Il existe une solution. Plutôt que de se focaliser sur les futurs agents pathogènes faisant peser de potentielles menaces sur les populations des pays riches, nous pourrions nous engager à protéger tout le monde, partout, des maladies infectieuses les plus meurtrières, parmi lesquelles le COVID-19, le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que d’autres menaces telles que la poliomyélite et Ebola, et les futurs agents pathogènes encore inconnus. Ce n’est pas seulement un impératif moral, c’est aussi une approche beaucoup plus efficace sur le plan pratique et politique. Les capacités de détection, de prévention et de riposte déployées pour les futurs agents pathogènes – concernant par exemple la surveillance des maladies, les chaînes d’approvisionnement et la fabrication en urgence – sont celles dont nous avons besoin aujourd’hui pour lutter contre les pandémies en cours. La meilleure façon de renforcer et de préserver ces capacités est de les utiliser : en effet, des muscles sollicités sont plus forts que des muscles au repos.
En outre, la plupart des menaces de demain trouvent leur origine dans les maladies d’aujourd’hui. Plus nous laissons ces dernières se développer, plus elles risquent de nous menacer, comme nous avons pu le constater avec les variants du COVID-19 ou la tuberculose multirésistante.
Améliorer la préparation aux pandémies en intensifiant la lutte contre les maladies existantes permettra de s’attaquer au problème qui a anéanti tous les efforts déployés jusque-là pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale : comment maintenir un intérêt politique et un financement lorsque le succès se mesure par l’absence d’action ? Sauver des vies tout en assurant la sécurité de tous est une proposition beaucoup plus convaincante et donc beaucoup plus durable. C’est aussi la meilleure chose à faire.
Quels que soient notre richesse et l’endroit où nous vivons, nous partageons tous la même planète. Le COVID-19 devrait nous pousser à remettre fondamentalement en question notre approche collective de la santé mondiale. Rebaptiser les anciennes notions de sécurité sanitaire mondiale en préparation et riposte aux pandémies n’est pas suffisant. De la même manière que les changements climatiques, la menace des pandémies exige une riposte mondiale plus audacieuse et plus inclusive. Nous devons protéger tout le monde, partout, des maladies infectieuses les plus meurtrières auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, et à celles auxquelles nous serons inévitablement confrontés demain.
Cette tribune est d’abord parue sur le site internet de La Croix.