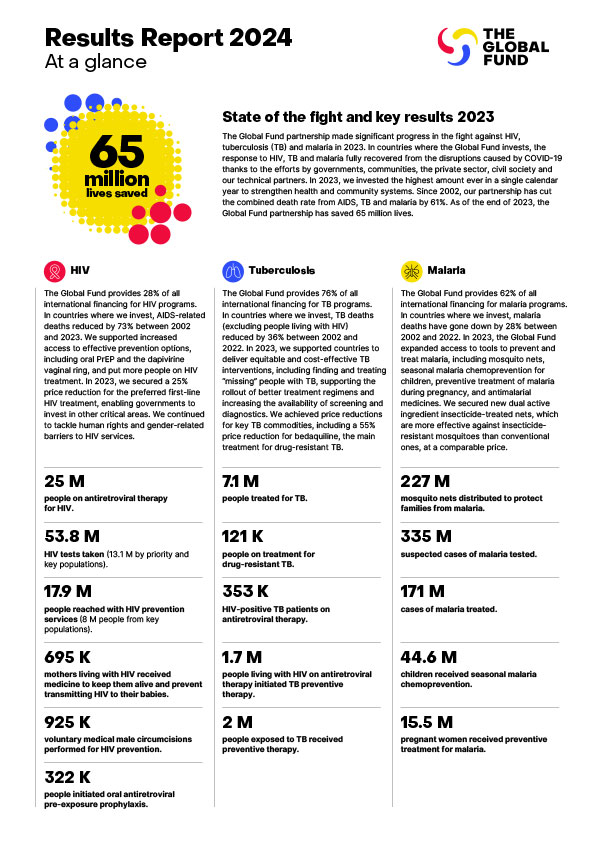Faites la connaissance de Mira Alimbaeva, survivante de la tuberculose pharmacorésistante et militante kirghize
J’ai découvert que j’avais la tuberculose par hasard. J’avais 22 ans et j’étais en troisième année de licence en Communication à l’Université kirghizo-turque Manas, à Bichkek, la capitale du Kirghizistan. Je devais passer différents examens en prévision d’une chirurgie, car j’avais de la difficulté à respirer par le nez. Le dernier examen était une radiographie thoracique. Lorsque j’ai reçu les résultats, je suis restée sous le choc : la radio indiquait un vraisemblable diagnostic de tuberculose.
Avant, je pensais que la tuberculose était une maladie bactérienne courante que tout le monde pouvait surmonter, mais au cours de mon traitement, j’ai réalisé à quel point cette maladie était éprouvante. Dans la société kirghize, il y a un problème de stigmatisation et de discrimination des personnes atteintes de la tuberculose. Et la longue durée du traitement rend notre vie encore plus difficile, car nous sommes isolés.
La première fois que je me suis sentie stigmatisée, ça a été avec ma docteure, tout au début de mon combat contre la tuberculose. J’étais dans sa salle de consultation et nous portions toutes les deux un masque. Elle a dit quelque chose que je n’ai pas compris, alors je me suis rapprochée. Elle m’a demandé de ne pas m’asseoir aussi près d’elle. « Va t’asseoir dans ce coin, m’a-t-elle dit. Je ne veux pas attraper ta maladie et devoir ensuite suivre un traitement ».
Ça m’a déconcertée et je me suis sentie seule. Si ma docteure – la personne responsable de mon traitement – me rejetait, comment pourrais-je lui faire confiance ? Lorsque mon traitement a commencé, je devais me rendre à l’hôpital tous les jours pour prendre mes comprimés. Je n’ai pas revu ma docteure. Quelque temps plus tard, j’ai découvert qu’elle avait transféré mon dossier pour que je sois suivie par un autre agent de santé. Elle ne voulait plus avoir d’interactions avec moi. Je n’ai pas remis en question son comportement envers moi, et je n’en ai parlé à personne. Mais elle m’a fait sentir que j’étais une menace pour la société, pour les personnes en bonne santé et pour mes parents, mes frères et sœurs et mes amis.
J’attendais aussi les résultats des tests pour savoir quelle forme de tuberculose j’avais, car cela allait déterminer la durée de mon traitement. Deux mois plus tard, j’ai appris que j’avais une tuberculose pharmacorésistante et que le schéma thérapeutique allait donc être beaucoup plus long. J’étais à nouveau sous le choc, et terrifiée. Je n’étais pas préparée à un traitement aussi lourd – ni mentalement ni physiquement. Je prenais vingt et un comprimés par jour ! Il s’agissait de puissants antibiotiques dont les effets secondaires bouleversaient chaque facette de ma vie. J’avais constamment des nausées. J’ai perdu beaucoup de poids. J’ai dû interrompre mes études et on m’a envoyée dans un hôpital spécialisé à quelques heures de Bichkek, dans une région rurale du Kirghizistan, loin de ma famille et de mes amis. Je n’étais pas habituée aux conditions, là-bas.
Mais dans mon malheur, j’ai eu de la chance : j’ai été sélectionnée pour un essai clinique de nouveaux médicaments. Parce que c’était un essai, ça a duré deux ans. Mais j’ai senti que je faisais quelque chose d’utile. Dans le cadre de cette initiative, j’ai rencontré une spécialiste de la communication qui travaillait pour la Fondation KNCV-TB, l’organisation non gouvernementale (ONG) associée à cet essai clinique. Elle m’a encouragée à soutenir les autres en écrivant des histoires sur la tuberculose en kirghize et en russe. Elle pensait que ce serait bon pour moi aussi. En parlant à d’autres patients atteints de tuberculose pharmacorésistante, j’ai découvert que bon nombre d’entre eux avaient été stigmatisés et discriminés. Certains avaient vécu des expériences pires que les miennes, ayant été rejetés par leur famille, leurs amis ou leurs collègues. Certains avaient aussi interrompu leur traitement à plusieurs reprises et en étaient à leur quatrième ou cinquième essai.
Ce travail avec d’autres patients atteints de la tuberculose m’a donné la force de finir mon traitement et de ne pas penser aux effets secondaires. Il m’a aidée à regagner confiance et à surmonter ma dépression. J’étais trop jeune pour mourir, et si je ne pouvais pas me faire confiance, à qui pouvais-je faire confiance ? J’avais encore un rôle à jouer dans la société. Je voulais être l’exemple d’un combat gagné contre la tuberculose pharmacorésistante et une voix pour celles et ceux qui font face à la stigmatisation et la discrimination.
Aujourd’hui, je suis une survivante de la tuberculose et j’en suis très fière. Mais il ne s’agit pas que de moi. Il y a mes parents, mes tantes, mes amis, l’ONG et les agents de santé qui m’ont soutenue. Nous avons traversé ça ensemble. Je tiens à les remercier, toutes et tous pour leur soutien et leur aide inestimables. Depuis, j’ai terminé mes études et j’ai commencé à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes de la tuberculose. Aux docteurs et aux agents de santé qui rencontrent des patients atteints de la tuberculose, je dirais : faites votre travail. Soyez professionnels. Soyez humains. Apprenez à communiquer avec vos patients atteints de la tuberculose, surtout lorsqu’ils apprennent qu’ils ont contracté la maladie et qu’ils se sentent vulnérables. Sensibiliser les gens à la tuberculose est aussi votre devoir : ce n’est pas une maladie sociale, c’est une maladie bactérienne que l’on traite avec des antibiotiques.
Mira Alimbaeva, originaire du Kirghizistan, est titulaire d’un master en Relations internationales de l’Université Eötvös Loránd, à Budapest, et membre du Conseil des jeunes du Fonds mondial. Elle défend les droits des patients atteints de la tuberculose et sensibilise à la stigmatisation et à la discrimination qui accompagnent la maladie dans la société kirghize.